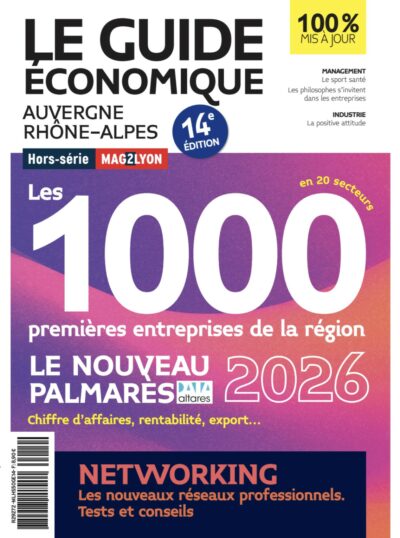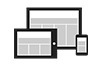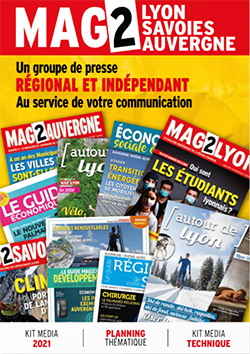Début 2024, pour analyser la crise agricole, Mag2Lyon avait donné la parole à Nathanaël Jacquart, président de la Fédération régionale de l’agriculture biologique et maraicher à Luzillat dans le Puy-de-Dôme, qui abordent tous les éléments de ce débat. Pour lui, les agriculteurs, en descendant dans la rue, ont d’abord voulu poser la question de leurs revenus et de la reconnaissance de leur métiers, et “il ne faudrait pas faire l’amalgame entre la norme écologique et la bureaucratie” qu’il juge lui aussi excessive.
Ce maraicher soulignait les conséquences de l’usage des pesticides : des cancers au cout de la dépollution. Et il déclarait : “Quand il faudra polliniser avec des drones parce qu’on aura épuisé la biodiversité cela coûtera très cher.” En forme de boutade? Pas sûr.
Crise agricole : Les réponses de l’agriculture bio
La dénonciation des normes écologiques a vite été identifiée comme une des principales revendications des agriculteurs. Excessives et irréalistes, elles condamneraient certaines cultures qui ne peuvent pas se passer de pesticides. Pourtant, plus de 60 000 exploitations agricoles sont déjà passées au bio en France, soit 14 % du total, pour près de 3 millions d’hectares. Avec 8 212 exploitations bio cultivant plus de 320 000 ha, déjà en bio ou en conversion, Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième région bio de France. Comment font-ils ? Mag2Lyon a interrogé l’un de ses agriculteurs, Nathanaël Jacquart, président de la Fédération régionale de l’agriculture biologique et maraicher à Luzillat dans le Puy-de-Dôme. Par Lionel Favrot
Avez-vous été surpris par le déclenchement de ces blocages agricoles ?
Nathanaël Jacquart : Le monde agricole va mal. Tout le monde s’accorde sur ce constat ! La question clé, c’est celle du revenu, malheureusement finalement passée sous silence. la fin. En revanche, on ne peut pas prévoir le départ d’un mouvement comme celui-ci car il est souvent spontané. Un rien peut le déclencher. Une contrariété administrative par exemple. Cela aurait pu partir d’un évènement dramatique comme, récemment, le suicide d’un agriculteur bio dans le Puy-de-Dôme. La part d’émotion est telle que les syndicats ne contrôlent plus rien dans ces circonstances. Les agriculteurs ont envie de faire savoir qu’ils en ont marre !
Vous-même, est-ce que vous avez participé aux blocages ?
Non. Ce mode de fonctionnement ne nous convient pas et nous ne partageons pas certaines revendications, notamment en ce qui concerne les normes visant à protéger l’environnement. En revanche, on a manifesté devant l’Assemblée nationale début février avec un slogan “bio et local, c’est l’idéal”. Certains médias l’ont relayé et une trentaine de députés sont sortis pour venir à notre rencontre.
Le Gouvernement a pourtant débloqué des fonds d’aide au bio il y a déjà deux ans…
Il y a eu un premier plan d’urgence en 2022 mais il éait insuffisant car il n’a touché que 10 % des producteurs. Exemple : les jeunes qui s’installaient n’ont pas été aidés. Agriculture en crise, ventes en berne… C’était certain que cela allait exploser.
L’agriculture bio est aussi en difficulté alors qu’elle semblait s’être démocratisée depuis quelques années ?
Oui, après une forte progression depuis 2015, elle est en grande difficulté.
Cette progression n’a pas commencé après la Covid comme certains l’affirment ?
Non, le mouvement était plus ancien et plus profond. Le lait bio a été le premier à se développer car il y avait une forte demande des consommateurs. C’est vrai que les confinements ont donné davantage l’occasion de cuisiner chez soi donc d’acheter des produits bruts plutôt que des produits indu-triels transformés. De plus, les consommateurs ont privilégié les produits locaux, bio ou non bio.
Cette hausse des circuits courts ne s’est pas accélérée après les déconfinements ?
Cela n’a pas duré à cause de trois paramètres : quand la Covid s’est terminée, les gens ont décidé de consacrer moins d’argent à l’alimentation pour s’offrir de nouveau des loisirs, notamment des voyages. Ensuite, l’inflation, notamment la hausse du coût de l’énergie, est venue diminuer le pouvoir d’achat et enfin la politique commerciale des industriels et des grandes et moyennes surfaces s’est ajoutée à cela. Les GMS ont réduit l’offre de produits en magasin, prétextant qu’elle était devenue trop importante vue cette baisse de consommation. En réalité, leur volonté était surtout d’augmenter leur rentabilité. Les GMS sont donc directement complices de la baisse de vente des produits locaux et bio car ils ont été les premiers à être retirés des linéaires. Les consommateurs ne peuvent pas acheter ce qu’on ne leur propose plus !
Tout le bio est touché ?
Il faut nuancer selon les types de production, les régions, les modes de commercialisation… Mais, globalement, on souffre d’un manque de revenus qui est aussi un manque de reconnaissance par rapport au travail accompli. Les agriculteurs bio fournissent des efforts importants pour faire attention à l’environnement en assurant une production de proximité pour une alimentation de qualité.
Les bio et les agriculteurs conventionnels se retrouvent donc sur cette critique des grandes surfaces ?Oui, il y a un vrai problème. En moyenne, la marge des agriculteurs a baissé de 4 % alors que celle des grandes surfaces a augmenté. Le partage de la valeur reste totalement inéquitable. On pourrait r.organiser de nombreuses filières. Les agriculteurs bio ont proposé d’aller plus loin dans la transformation des produits plutôt que de l’abandonner aux industriels. Les GMS sont en position de force face à nous. Si on était davantage rassemblés, par exemple en coopératives, on serait au moins à égalité pour les discussions sur le prix, les marges arrière, etc.
Toutes les grandes surfaces se comportent de la même manière ?
Le facteur déterminant, c’est le mode de négociation. Les centrales d’achat sont beaucoup plus dures avec les agriculteurs. Tout se règle par le prix. Au contraire, si on négocie directement avec le responsable fruits et légumes d’un magasin, c’est plus constructif. Il va chercher à développer des partenariats avec les filières locales.
Les magasins bio ont-ils un comportement différent des grandes surfaces classiques ?
Oui. Dans les magasins bio que je connais, on a plus souvent l’occasion de discuter avec un responsable de magasin ou de rayon qu’une centrale d’achat. Il faut préciser qu’ils sont généralement plus petits car ils visent une distribution à taille humaine.
Et les chaines comme Biocoop parfois critiquées ?
Biocoop a aussi des centrales d’achat mais avec une démarche de contractualisation sur plusieurs années pour les producteurs. Il s’agit d’un commerce équitable nord-nord sur le modèle du commerce équitable nord-sud qui préserve justement les revenus du producteur. Cela nous donne donc une meilleure visibilité qu’avec la GMS classique. Cette démarche de contractualisation fonctionne bien et il faudrait la développer. Ce qui était d’ailleurs un peu le sens de la loi Egalim au départ !
Est-ce qu’il y a ce type de démarche de contractualisation dans la région ?
J’ai entendu parler du GRAP (1) autour de Lyon qui fournit des magasins en circuits courts avec également des partenariats avec des producteurs, mais pas suffisamment pour en parler. En Auvergne, on a créé Auvabio qui réunit une cinquantaine de producteurs. On vend aux magasins bio mais aussi aux restaurants et aux hôtels, un peu à la GMS, aux transformateurs… Ce qui démontre qu’on peut faire tourner nos exploitations et les magasins en même temps.Tout le monde s’y retrouve.
Pourquoi ces démarches ne sont-elles pas plus systématiques ?
Parce que ces structures sont difficiles à faire vivre car globalement, le collectif c’est dur. Ensuite cela coûte du temps et de l’argent. On doit stocker ensemble, planifier ensemble les livraisons… Je crois que cela demande un accompagnement des pouvoirs publics pour se généraliser. En particulier au démarrage.
Le problème du bio, ce n’est pas qu’il est trop cher ?
C’est parce qu’on prend le problème à l’envers ! Le bio n’épuise pas les sols, ne pollue pas ni la terre, ni l’air, ni l’eau… En circuit court, ce qui est le plus cohérent, l’impact carbone de sa production est moindre. Il contribue donc moins au réchauffement climatique. Ce sont les produits non bio qui devraient être beaucoup plus chers pour payer leurs dégâts car dépolluer coûte très cher. C’est une distorsion de concurrence ! Quand il faudra polliniser avec des drones parce qu’on aura épuisé la biodiversité cela coûtera très cher.
Êtes-vous optimiste sur le comportement des consommateurs ?
Je suis par nature optimiste. Vu l’accélération des conséquences du réchauffement climatique, de plus en plus visibles, la prise de conscience devrait s’accentuer. Arrêtons de nous raconter des histoires. Il va falloir changer certains paramêtres si on ne veut pas manquer d’eau beaucoup plus vite que prévu. Je suis aussi conscient que cela peut faire peur et que les gens peuvent avoir un autre raisonnement : puisque c’est désormais inéluctable, autant profiter du moment et continuer sans se poser de question. Pourtant, on a chacun les clés pour faire évoluer les choses.
Le Gouvernement a-t-il pris les mesures de la crise ?
Non. Il traite cela comme une crise agricole de plus en lâchant quelques millions d’euros par là et en mettant en pause le plan Ecophyto pour que les agriculteurs rentrent dans leurs fermes.
Cette exigence de suspendre la réduction des pesticides semble en contradiction avec les nouvelles attentes des consommateurs ?
Là, je ferais un pas de côté ! Pour une raison simple : il est indispensable de r.duire l’usage des pesticides mais ce plan Ecophyto est mal embringué depuis le d.part. On est parti d’un objectif de réduction de 50 % et comme cela ne marchait pas, les chiffres ont été triturés à chaque révision pour faire croire qu’on allait dans le bon sens ! Globalement, la consommation de pesticides augmente malgré ce plan qui a coûté des millions d’euros. Il faut garder l’objectif de réduction des pesticides mais changer la méthode. En plus, on n’a jamais vraiment su si on nous parlait d’une baisse en volume, en surface traitée, en nombre de traitements… Ce n’est pas clair et cela ne donne aucune perspective ni aux producteurs ni aux consommateurs.
Qu’attendez-vous pour ce plan Ecophyto ?
Une révision avec des objectifs clairs et précisés de manière beaucoup plus fine. Pour le moment, les agriculteurs ne voient que le côté paperasse. Ce qui est important c’est de montrer la finalité : baisser les traitements diminuera les cas de cancer, à commencer chez les agriculteurs qui sont les premiers touchés. On compte bien plus de leucémies chez les agriculteurs ! Ce plan ne se fait pas contre eux mais pour eux.
Comment souhaitez-vous que ce plan ecophyto soit revu ?
Le meilleur objectif d’un plan Ecophyto serait d’aller vers la bio !
Pourtant, la FNSEA affirme que certaines cultures sont impossibles sans pesticides et le Gouvernement lui a promis de n’édicter aucune interdiction sans solution !
Les alternatives aux pesticides existent dans toutes les productions et l’agriculture biologique les utilise tous les jours.
Vraiment ? Alors pourquoi ce discours de la FNSEA ? L’un de ses représentants affirme qu’enlever 50 % des pesticides ce serait comme enlever 50 % des touches d’un clavier et d’essayer de se servir d’un traitement de texte !
Il ne faut pas nier les difficultés sur quelques points. On peut donc encore s’améliorer. Mais réduire trés fortement les pesticides, c’est envisageable.
Ce n’est pas trop difficile la conversion en bio ? Qu’avez-vous l’impression d’avoir sacrifié ?
Rien. J’ai vraiment l’impression de n’avoir rien sacrifié. Je compte même aller plus loin en n’utilisant même pas les traitements autorisés en bio car je constate que toutes ces interventions déséquilibrent nos cultures. On peut arriver à produire des fruits et des légumes avec des rotations pas trop intensives et en préservant la biodiversité. pour une vie du sol plus équilibrée. C’est vrai que cela exige davantage de main d’oeuvre, mais je préfère payer un salarié sur mon exploitation où je produis des légumes et un peu de fruits que de me payer un épandeur ou un pulvérisateur ! Je discute avec lui, ce qui permet des échanges sociaux. Il vit ici et participe donc à la revitalisation de nos campagnes.
Que répondez-vous aux arboriculteurs qui affirment vraiment ne pas avoir de produits pour certaines cultures ?
Qu’ils n’ont pas le bon mode de pensée. Moi, en agriculture biologique, je ne remplace rien par rien. Je cherche à me passer de traitement. Je réfléchis différemment, notamment en amont en faisant de la prévention. Exemple : pour éviter les pucerons, je limite les apport d’azote au stricte minimum avec un peu de purin voire du compost. Je fais des apports fractionnés d’azote quand la plante est fragile en début de croissance. En effet, l’azote entraine une croissance rapide, et cette croissance rapide renforce l’appétence des cultures pour les pucerons qui viennent plus vite et se développe plus fort. C’est seulement en cas de maladie que la bio prévoit certaines solutions de remplacement mais je ne les utilise plus personnellement.
D’autres exemples d’alternatives ?
Le vers qui attaque la pomme. Pour réduire ce risque, on peut introduire des volailles dans le verger. Ce qui implique une vision systémique de l’exploitation au lieu de réfléchir production par production ou variété par variété. Il faut déspécialiser. En plus, les poules feront des crottes qui serviront aux arbres.
Pourquoi ces solutions ne sont pas plus utilisées ?
Parce qu’on a spécialisé l’agriculture pour simplifier les cultures. Mais cela a nécessité des investissements. Aujourd’hui, on nous parle de se servir de drones. Ce qui alourdit l’endettement des exploitations. Quand on est endettés voir surendettés, on est pieds et poings liés. On ne peut pas s’adapter aux changements climatiques. Ce qui enlève le peu de résilience que pourraient avoir les fermes à s’adapter à cette succession de crises.
Vous vous passez aussi d’engrais ?
Les agriculteurs utilisent beaucoup d’azote qui, en plus, vient de Russie. C’est normalement interdit mais il y a visiblement des montages pour les importer… Or on peut développer des engrais verts. Sur ma ferme, j’ai un petit troupeau de brebis pour qu’elles apportent de la matiére organique pour les cultures. C’est possible et même généralisable.
Comment cela marche ?
En septembre, je sème un engrais vert composé d’une légumineuse et d’une céréale. La légumineuse a l’avantage de capter l’azote qui est dans l’air pour le stocker dans ses feuilles et la céréale capte le carbone. En mars-avril, je fais pâturer ce champ par mes brebis jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien et juste après je plante mes choux et poireaux. Ils n’ont alors besoin d’aucun apport. Ce qui demande de ne plus réfléchir les cultures par tranches de saucisson mais d’avoir une vision plus large pour identifier les coopérations possibles sur la ferme ou entre fermes.
Aucune impasse pour la bio ?
Contre le doryphore de la pomme de terre, on avait le Novodor, une préparation à base d’un bacillus hyper-spécifique qui bloquait la digestion du doryphore. Du coup, il était sans danger pour l’agriculteur et la nature. Malheureusement, la firme qui le produit n’a pas déposé de nouvelles autorisations sur le marché car il lui a paru trop petit et pas assez rentable. On utilise donc le spinosad, un insecticide àbase d’une molécule végétale et sans rémanence, mais qui n’est pas très bonne pour notre santé.
Les jeunes agriculteurs qui s’installent, se tournent davantage vers la bio ?
Leurs manières de s’installer peuvent leur permettre justement de réfléchir l’agriculture différemment. Ils ne veulent plus se retrouver seuls comme leurs parents et ne pas prendre de vacances mais au contraire s’installer en société pour pouvoir se relayer et s’entre-aider. Cela peut ouvrir à la mise en place de nouvelles coopérations et de nouvelles pratiques.
Que pensez-vous des zones de non-traitement que la FNSEA veut faire retirer ?
C’est un vrai scandale cette affaire ! Il existe des zones de non traitement à proximité des habitations et des écoles. Revenir en arrière, ce serait marcher sur la tête ! L’OMS a encore alerté sur la hausse des cancers dans les prochaines années en précisant que les pesticides en sont une des principales causes. Il faut aussi des ZNT proches de l’eau car la polluer impacte la biodiversité et c’est très cher de dépolluer.
Des agriculteurs affirment avoir des champs entiers dans ces zones, ce qui les empêche de cultiver !
On pourrait en faire des zones de jachéres pour préserver la biodiversité ou cultiver du bio sans traitement.
La FNSEA réclame la fin des jachères imposées par l’Europe. Etes-vous favorable au maintien des jachères ?
Si le seul objectif c’est de ne pas produire en France et ensuite de devoir importer des produits agricoles, non. En revanche, pour moi qui suis en agriculture bio, c’est hyper-important car cela va favoriser la biodiversité donc la présence de coccinelles pour réguler les pucerons. C’est aussi des pièges à carbone.
Globalement, vous ne dénoncez pas les normes écologiques comme la FNSEA ?
Non. Mais on peut se retrouver sur l’excès de bureaucratie. Respecter des dates pour couper des haies, c’est bien. Mais le faire à un jour prés, ce n’est pas si grave. Ne faisons pas l’amalgame entre la norme écologique et la bureaucratie. Faisons de l’éducation plutôt que de rentrer dans les discours populistes. Ma conviction c’est qu’on pourrait faire beaucoup mieux qu’aujourd’hui.
Aujourd’hui, on a l’impression que le mouvement est parti d’une colère de paysans en difficulté avant d’être récupéré par la FNSEA qui en a profité pour faire passer ses propres revendications…
C’est clair que les agriculteurs à l’origine des blocages se sont fait voler leurs revendications. Au départ, il était question de défendre les revenus des agriculteurs. Or, aujourd’hui, dans les annonces du Gouvernement, il n’y a quasiment rien !
150 millions d’euros débloqués pour les éleveurs de bovins et 50 millions pour le bio, c’est suffisant ?50 millions pour le bio, si on ramène cette somme au nombre de producteurs bio, cela ne fait que 800 € par ferme ! Et pour les éleveurs bovins c’est guère mieux. Le Gouvernement nous promet d’améliorer la loi Egalim mais elle est déjà depuis six ans en échec… La FNSEA a demandé aux agriculteurs de rentrer dans leurs fermes sans obtenir une vraie amélioration de la situation.
(1) Voir les hors-séries ESS de Mag2Lyon