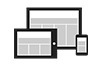La Convention citoyenne sur la fin de vie, composée de 150 citoyens tirés au sort, a rendu ses conclusions en avril. Elles sont favorables à l’ouverture de l’euthanasie et/ou du suicide assisté. Emmanuel Macron a annoncé, le 3 avril, la mise au point d’un projet de loi sur la fin de vie d’ici à la fin de l’été. Pour le Dr Guillaume Economos, médecin en soins palliatifs à Lyon Sud, l’urgence est d’abord de permettre à tous les citoyens d’accéder à des soins palliatifs. Interview. Par Maud Guillot.
Pourquoi un médecin aussi jeune que vous se retrouve-t-il dans cette spécialité si particulière ?
Dr Guillaume Economos : Quand j’ai fait médecine, je n’imaginais pas me passionner pour les soins palliatifs… Mais comme souvent, c’est affaire de rencontre. J’ai trouvé un mentor en la personne de Gisèle Chvetzoff, directrice du département interdisciplinaire de soins de support au Centre Léon Bérard. C’est une femme incroyable qui m’a transmis l’idée de “prendre soin” plus que de “soigner et guérir”. Parfois, quand on tente d’augmenter les soins, on abime la qualité de vie.
En fait, elle vous a appris en tant que médecin à renoncer à guérir…
Oui, mais ce n’est pas un renoncement au sens où on ne fait pas ce choix, contrairement aux oncologues qui se battent jusqu’au bout. Quand le patient arrive dans nos services, la maladie et les éléments de vie ont déjà fait avancer cette réflexion. On sait qu’on a atteint les limites imposées par les connaissances scientifiques et les moyens actuels. Notre objectif n’est plus la survie, mais la qualité de la fin de vie. C’est ce à quoi on s’emploie chaque jour. Bien sûr, on est confrontés à la mort. Ce n’est pas toujours facile. Mais on est vraiment dans le “prendre soin”.
Quel est le profil des patients que vous recevez dans votre service ?
La vocation de notre service est d’accueillir les patients incurables, à un stade avancé : cancers, pathologies neuro-dégénératives, insuffisance cardiaque ou rénale.. Du fait du recrutement oncologique de Lyon Sud, on traite surtout des cancers. Tous les patients en situation palliative ne passent pas chez nous. La plupart des malades sont suivis à domicile, dans des unités hospitalières classiques… On a aussi une unité mobile. Nous, on est là pour gérer les situations complexes ou des symptômes réfractaires : douleur résistante, troubles respiratoires ou digestifs… On tient aussi compte de la situation sociale et psychologique des patients.
Vous expliquez que la démarche palliative ne se limite pas à la fin de vie. Que voulez-vous dire ?
Les soins palliatifs doivent être intégrés de façon précoce dans la prise en charge du cancer. Ils ne doivent pas pallier la fin de vie, de toute façon ils ne le peuvent pas, mais pallier les symptômes pour améliorer la qualité de vie, d’autant que les traitements sont lourds et impactants. Plus on soulage les effets indésirables, nausées et les douleurs, plus les traitements seront tolérés donc durables. On encouragera aussi les interactions sociales, ce qui joue sur l’état psychologique.
Mais honnêtement, pour un patient atteint d’un cancer comme pour ses proches, l’annonce d’une prise en charge par les “soins palliatifs” signe la fin…
Il y a effectivement une réaction un peu épidermique chez les patients, mais aussi parfois chez les praticiens. C’est une vision malheureusement très française, héritée des hospices… Le terme “soins palliatifs” est même aujourd’hui questionné. Au Centre Léon Bérard, on parle désormais de soins de support oncologiques. Certains patients sont admis précocement dans notre service pour une prise en charge de la douleur afin de continuer leur traitement.
On imagine parfois que votre métier consiste à tenir la main des patients mourants… Qu’en est-il en réalité ?
Ce n’est pas vraiment ça : notre spécialité est très technique. Elle s’est développée historiquement en contrepied des autres disciplines qui étaient très, voire trop, techniques. Notre objectif était alors de rappeler l’importance du patient qui doit être au centre du soin. Aujourd’hui, les autres disciplines ont fait le chemin inverse et les soins palliatifs peuvent revendiquer leur aspect technique à travers la recherche, l’expertise sur la gestion de la douleur par des traitements antalgiques… En effet, on manipule beaucoup de stupéfiants : morphine, kétamine ou cannabis à usage médical.
Mais cette spécialité nécessite un peu de psychologie et d’épaisseur humaine…
Oui, il faut avoir une vision un peu complète du malade. On n’est pas des spécialistes d’un organe. On doit s’intéresser à sa psychologie, son environnement personnel, sa famille voire sa spiritualité… On peut faire la parallèle avec la pédiatrie et la gériatrie qui intègrent ces dimensions. Quand on accompagne sur la fin de vie, il faut savoir écouter l’autre et comprendre ce qui fait sens pour lui… Mais beaucoup de confrères, dans d’autres spécialités, ont tout à fait ces qualités !
Quelle est la nature du projet Inspire que vous portez ?
Il a été développé conjointement avec le King’s College à Londres, qui dispose d’un institut de soins palliatifs et de rééducation. On va proposer des interventions de réhabilitation à des patients atteints de cancers qui ne se guériront pas mais dont l’espérance de vie n’est pas connue… On n’a pas de boule de cristal mais si on prend le cas d’un cancer solide, on sait que s’il n’est pas opérable et qu’il est métastatique, on ne parviendra pas à enlever toutes les cellules tumorales.
En quoi vont consister ces “interventions de rééducation” ?
On va demander à un nutritionniste, un diététicien, un kiné, ou un ergothérapeute… de venir évaluer les symptômes du malade. Ils lui proposeront des solutions pour améliorer sa qualité de vie, en fonction de ce qui compte pour lui. Exemple : l’essoufflement n’est pas vécu de la même façon par tous. Pour certains, c’est un handicap pour sortir, pour d’autres non. On va donc proposer trois “interventions”, sans médicament, pour les aider au quotidien. Ce qui réduira aussi à terme leur temps d’hospitalisation.
Mais ces prises en charge de “bon sens” n’existent-elles pas déjà ?
Pas chez des patients incurables. On soutient ceux qui pourraient s’en sortir et ceux qui s’en sont sortis car l’objectif est le retour à une vie dite normale, avec la famille, le travail… On le fait quand c’est “utile”. On avait oublié les autres patients… Nous, on parle de prise en charge purement “humaine” pour que la patient se sente bien. L’utilité sociale, on ne s’en préoccupe pas.
Mais il existe des budgets pour ça ?
Les soins palliatifs sont plutôt rentables car ils disposent d’une cotation particulière. Heureusement.. Ce dispositif nous permet d’oublier cette donnée financière. Mais pour Inspire, on a obtenu un financement européen en passant par le plus gros appel à Projet mondial Horizons Europe, qui encourage l’excellence de la recherche. On devrait être une dizaine de professionnels, dont deux recrutements.

Combien de patients vont être inclus ?
144 patients sur deux ans. On commencera dans 13 mois car il faut fixer le protocole. Nous, on va devoir évaluer si on peut appliquer ces interventions dans la vraie vie : sont-elles souhaitables ? A-t-on le personnel adapté ? Combien coûteront-elles ? On va recruter des patients dans plusieurs pays européens : Italie, Angleterre, Norvège… Ça nous permettra de mieux comprendre l’influence des cultures locales sur ces objectifs. On s’est engagé à fournir des résultats dans quatre ans.
Cette étude a des objectifs louables mais on constate aujourd’hui que de nombreux patients n’ont tout simplement pas accès aux soins palliatifs de base en France !
Justement. L’objectif de notre étude est de généraliser cette prise à charge à l’ensemble des malades atteints d’un cancer, à l’hôpital ou non. Par ailleurs, je suis totalement d’accord. A Lyon, notamment aux HCL, on a de la chance, mais on n’a pas suffisamment développé les soins palliatifs pour permettre un accès équitable pour tous en France. Ce combat est loin d’être terminé. Les ARS manquent de financement. Les professionnels ne sont parfois pas bien formés. J’ai déjà entendu des patients avec un cancer avancé dire que leur médecin refusait de leur prescrire de la morphine par crainte qu’ils deviennent “addict”. Ce n’est plus possible…
Mais le progrès est lent car on évoque ces carences depuis près de 20 ans !
C’est multifactoriel. Les différents plans de développement se sont soldés par des échecs. D’abord, l’enveloppe financière n’est jamais suffisante. Ensuite, on manque d’universitaires qui donnent des cours sur les soins palliatifs aux jeunes médecins. Dans notre spécialité, la démographie médicale ne joue pas en notre faveur.
Quelle est votre position sur une éventuelle évolution de la loi ?
Pour moi, la priorité c’est de développer les soins palliatifs. Beaucoup de gens n’ont pas accès au traitement de leur douleur. Or on constate que quand on la soulage, la demande d’euthanasie diminue. Pour autant, la médecine n’est pas toute puissante. On vit des situations d’échec : certains patients réclament une mort anticipée malgré les soins palliatifs. Ils n’en peuvent plus. Il faut l’admettre. Et ça n’est pas un désaveu de notre spécialité qui doit encore se développer.
Comment faire pour ces patients ?
Je ne suis pas contre une légalisation d’une forme d’aide médicale à mourir, par compassion. Mais après consultation d’un professionnel des soins palliatifs. Par ailleurs, il faut distinguer un suicide assisté d’une aide médicale à mourir. L’opinion publique n’a pas tous les éléments éthiques pour bien comprendre.
Quelle est cette différence éthique ?
Dans le cas de l’euthanasie, un tiers donne la mort. Pour moi, ce n’est pas possible, c’est un interdit éthique et sociétal. Dans le cas du suicide assisté, on donne au malade les moyens de mettre fin à ses jours, en “sécurisant” la procédure. Ce qui est possible même pour un tétraplégique, qui peut par exemple déclencher le traitement par des battements de cils.
Mais pour les personnes qui ne peuvent pas exprimer cette volonté, si elles sont dans le coma ?
On voit bien qu’il restera toujours des situations non couvertes par la loi… Car ce sujet est complexe. Même les directives anticipées, ce n’est pas un outil idéal car elles contreviennent parfois à l’avis médical qui considère la persistance des soins comme déraisonnables…
Vous seriez prêt à participer à ce processus d’aide médicale à mourir ?
Non, car cela galvaude mon objectif de soin. Moi, je suis là pour informer et éclairer le patient afin de l’aider à prendre une décision. Je ne suis pas là pour accélérer sa fin.
Mais c’est un secret de polichinelle que des médecins ont déjà accéléré la mort de leur patient…
Mais quel est le sens d’accélérer un processus naturel qui va survenir à court terme ?
Mettre fin à une situation intenable !
Pour qui ? Pour le patient ? Ses proches ? Si on accompagne correctement les familles, notamment au niveau psychologique, on peut changer leur vécu. Les derniers moments, s’ils sont apaisés, peuvent être très riches… Le deuil sera mieux vécu après. En tout cas, on ne fait jamais ça dans notre service. Mais c’est vrai que ça nécessite des moyens humains, des psychologues, des infirmières…
Le personnel, ça coûte cher.
Une loi favorable à l’euthanasie qui est soutenue par 80 % des Français serait une solution plus simple…
C’est dramatique de légiférer suite à un échec de notre société. On n’est pas capable de faire autrement ? C’est certes moins cher et plus facile mais on parle quand même d’êtres humains. On doit pouvoir proposer toutes les solutions possibles au patient. Ensuite, il sera vraiment libre de faire ses choix. Il pourra réellement reprendre le contrôle sur sa fin de vie.