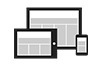Le journaliste Mathieu Palain s’est plongé pendant quatre ans dans le sujet des violences faites aux femmes, notamment à Lyon. Il en a tiré un podcast diffusé sur France Culture et un livre Nos pères, nos frères, nos amis qui vient de paraître. Un récit nécessaire alors que 220 000 femmes déposent plainte chaque année. Interview.
Pourquoi avez-vous choisi Lyon pour commencer ce reportage ?
Mathieu Palain : Un de mes contacts à l’administration pénitentiaire avait atterri au Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Rhône. Il m’a appelé pour me demander si le sujet des violences faites aux femmes m’intéressait. Des groupes de prévention de la récidive, destinés à des hommes violents et condamnés, sont mis en place à Lyon. J’étais intéressé par le côté groupe : 12 personnes qui se retrouvent les vendredis et qui se reconnaissent entre pairs. J’imaginais les groupes de parole comme dans les séries ou les films tel que Fight Club. Je m’attendais à entendre “Je m’appelle X ou Y, j’ai tel âge et je frappe ma femme”.
Vous n’avez pas entendu cette phrase au cours de vos 4 ans sur le terrain…
Oui, ça a été la première surprise pour moi. En réalité cette phrase est impossible à prononcer. Le déni permet de continuer à se regarder dans la glace. À force de se répéter qu’ils ne l’ont pas fait, ils s’en persuadent. Certains se disent victimes d’une machination, liée au mouvement MeToo. Ils ont été condamnés en 2018, peu de temps après l’émergence de ce mouvement mondial qu’ils ont du mal à saisir. Ils pensent que la justice est entre les mains des femmes qui se vengent de siècles et de siècles de patriarcat.
Ils ont l’impression d’avoir perdu le pouvoir face à l’émancipation des femmes…
Certains disaient : “On ne peut plus rien dire, plus rien faire… Je ne me remettrai jamais en couple sinon c’est sûr que ça va se retourner contre moi.” Ils partent du principe que la récidive est inévitable.
Les hommes violents constituent le point de départ de votre livre. Puis vous rencontrez des victimes. Ça vous semblait indispensable de recueillir les deux points de vue ?
On a tendance à vouloir classer les gens entre les gentils et les méchants avec une vision assez manichéenne. Quand on est tout le temps du côté des coupables, on a un biais cognitif. Ce sont des êtres humains. Il y a de l’empathie, vous vous attachez à eux… De l’autre côté on a tendance à ranger les auteurs de violences dans une représentation monstrueuse. Je ne pense pas non plus que ça permette d’avancer.

À Lyon, vous avez rencontré Liliane Daligand, médecin légiste et psychiatre spécialiste de ce sujet. 20 % des femmes hébergées par son association retournent habiter chez leur conjoint violent…
Oui, elle parle d’addiction à la violence. Il y a un effet de rechute même chez certaines victimes. Heureusement pas toutes ! De la même manière qu’il est difficile de se séparer de quelque chose qui a fait partie de votre vie au quotidien, que ce soit la cigarette ou l’alcool. On aimerait que les victimes coupent le lien de manière brutale. C’est plus compliqué que ça, il y a parfois besoin de plusieurs allers-retours. Les femmes battues reviennent parce que leur compagnon s’est excusé, leur a fait des promesses ou des cadeaux… Liliane Daligand raconte que certaines femmes hébergées, qui ont failli y passer, continuent de décorer leur chambre avec des photos de leur conjoint. C’est glaçant !
Vous vous êtes aperçu au fil de votre travail de terrain que ces violences concernent tous les milieux sociaux ?
C’était une évidence ! De la même manière que les viols et l’inceste concernent tout le monde. Je le savais mais j’avais du mal à le prouver sur le terrain. Statiquement les hommes qui ont été condamnés et qui intègrent les groupes comme celui du SPIP de Lyon appartiennent aux catégories socio-professionnelles les plus basses avec quelques exceptions. J’ai eu la chance de diffuser ce podcast sur France Culture. J’ai reçu des témoignages de femmes racontant exactement les mêmes violences sauf qu’elles mettaient en cause des chef d’entreprise, directeur de théâtre, kiné, cardiologue, avocat, universitaire… Il y a les mêmes problèmes de chaque côté de l’échelle sociale.
Comment expliquez-vous que ça se sache moins ?
Il y a plusieurs facteurs… Tout d’abord la promiscuité dans les milieux sociaux les plus défavorisés. Dans un HLM, tout l’immeuble sait que la femme du 4e ou du 5e se fait taper dessus… Même si personne n’agit ! Un jour elle criera plus fort et un voisin appellera la police. C’est moins le cas quand vous habitez dans une maison. Dans les milieux sociaux les plus aisés, il y a une sorte de petite respectabilité à tenir. Il est parfois difficile de briser ça. Il y a une autre réalité : la justice ne condamne pas de la même manière. Quand on voit l’affaire Adrien Quatennens… Je le cite parce qu’il est l’exemple qu’on a sous les yeux. 4 mois avec sursis pour une affaire de violences conjugales qui va au tribunal ce n’est pas grand-chose !
Liliane Daligand met également en avant un rapport incestueux de nombreux auteurs de violences conjugales avec leur mère…
C’est assez classique. Liliane Daligand a expertisé environ 700 auteurs de violences conjugales. Elle remarque très régulièrement cette opposition entre la conjointe et la mère. Des discours tels que : “Ma mère c’est ma déesse, je pourrais mourir pour elle, tuer pour elle… ” Souvent avec l’idée sous-jacente qu’elle en a tellement bavé toute sa vie. Le père était pour le moins difficile à gérer et souvent violent. Ce sont des propos que j’ai entendus dans le groupe à Lyon.

Ils n’ont pas conscience de l’impact sur leurs enfants alors que la plupart d’entre eux ont subi des violences plus jeunes…
Oui, il faut travailler sur le trauma et sur la répétition potentiellement de violences subies… À quel point avoir été exposé à la violence enfant peut nous marquer ? Presque tous ces hommes racontent avoir rencontré la violence dans l’enfance. J’évoque “la contagion de la violence” en citant l’épidémiologiste américain Gary Slutkin. Dans les années quatre-vingt-dix, il a commencé à traiter la violence comme une épidémie. En quelques années, la criminalité a chuté de 50 % à Chicago. Ces gars n’ont pas du tout envie de ressembler à leur père.
Vous voyez là une manière de rompre le cycle de la violence ?
C’est le but ! Est-ce qu’on répète sans arrêt les mêmes schémas d’éducation pour recréer potentiellement des coupables et des victimes ? Ou est-ce qu’on décide de changer quelque chose et d’aller vers une éducation moins stéréotypée qui va créer moins de garçons qui ne confient pas leurs sentiments, qui ne savent pas gérer le conflit autrement qu’en sortant leurs poings ? Pourquoi est-ce que ces hommes s’emportent ? Il n’y a jamais de bonne raison ! Mais ils ne se souviennent même pas de cette raison la plupart du temps. C’est hyper futile. Comment ne pas utiliser la violence comme un moyen de résoudre un rapport de force ? Et comment ne pas envisager l’autre comme un adversaire ?
Cet article vous intéresse ? La suite à lire dans le numéro de novembre 2022 : c’est par ici !